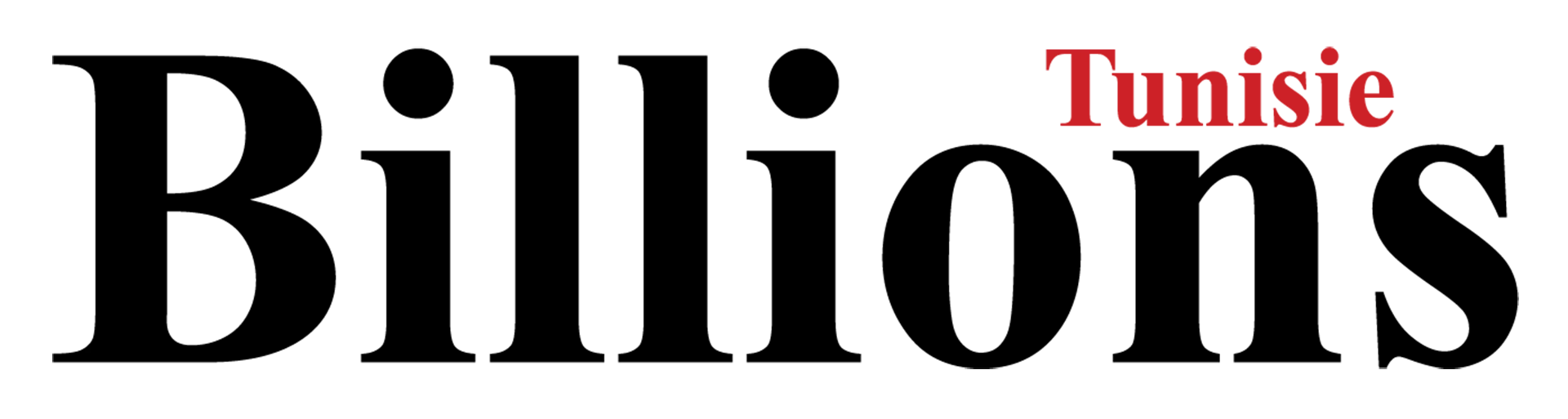En 2024, la Tunisie a franchi une étape significative dans la gestion des flux migratoires en devenant une zone de recherche et de sauvetage (SAR). Cette décision, fruit des accords avec l’Union européenne, oblige la Tunisie à intercepter les navires transportant des migrants et à les ramener sur son sol. Ce changement a été largement influencé par Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui a joué un rôle crucial dans les négociations.
Pour Giorgia Meloni, cette réalisation représente un alignement favorable des événements. Non seulement son camp a remporté les élections européennes de juin 2024, mais elle a également renforcé la position de l’Italie en Méditerranée en luttant contre les flux migratoires. Sa persévérance a conduit à la création de cette zone SAR tunisienne, formalisée par le Centre de coordination du secours maritime de Tunis.
Changement de Cap pour Kaïs Saïed
Concrètement, cette zone maritime, qui dépasse les eaux territoriales tunisiennes, est désormais sous la responsabilité de la Tunisie. Ce pays doit déployer ses navires pour les opérations de secours et ramener les migrants interceptés ou secourus vers des ports situés sur son territoire.
Il y a moins d’un an, le président tunisien Kaïs Saïed déclarait que la Tunisie ne souhaitait pas exercer un contrôle externalisé sur les frontières européennes. Cependant, Giorgia Meloni a su lever ces réticences. Le 4 juin 2024, elle a annoncé la formation d’un groupe de travail italo-tunisien pour établir cette zone SAR, conformément aux normes de la Convention de Hambourg. Le 19 juin, l’Organisation maritime internationale a officialisé l’accord, bien que cette annonce soit passée inaperçue dans les médias tunisiens.
Une coopération codifiée
Jusqu’à présent, la Tunisie refusait d’adhérer au principe de zone SAR, considérant cela comme une perte de souveraineté. Le chapitre 3 de la Convention SAR stipule que les États doivent coopérer pour permettre aux unités de sauvetage d’autres pays d’entrer dans leur mer territoriale ou de les survoler pour des opérations de sauvetage, sous réserve des lois nationales. En pratique, ces interventions avaient déjà lieu, mais les formaliser sous l’étiquette « zone SAR » permet de mieux les encadrer et d’empêcher un revirement de la Tunisie.
Objectif : Lampedusa
Certains observateurs notent cependant que le Conseil d’État italien a refusé, le 20 juin 2024, l’envoi de six vedettes à la Tunisie, après un recours d’ONG italiennes qui contestent ce transfert et le financement de leurs réparations. Malgré cela, l’objectif de Rome est clair : empêcher les migrants d’atteindre Lampedusa en obligeant la Tunisie à bloquer leur route.
Défis et controverses à venir
La tâche ne sera pas simple pour les autorités tunisiennes, qui devront naviguer entre les zones SAR italiennes et libyennes. Des conflits et polémiques en haute mer sont à prévoir, surtout que l’UE considère la Libye et la Tunisie comme des « pays sûrs » pour les migrants, malgré les nombreux rapports d’exactions commises en Libye.
En Tunisie, les conditions des migrants restent précaires. Ils vivent notamment dans des campements sauvages à El Amra, près de Sfax, sans droits ni existence légale. Depuis la signature d’un Mémorandum d’entente en juillet 2023 entre l’UE et la Tunisie, le nombre de migrants arrivant en Italie depuis la Tunisie et la Libye a diminué, passant de 60 000 au premier trimestre 2023 à 20 000 en 2024.
Cependant, les 900 millions d’euros d’aide européenne promis n’ont toujours pas été débloqués, le FMI ayant gelé toutes les aides à Tunis. Giorgia Meloni s’engage à faire le nécessaire, mais pour l’instant, comme le dit un vieux proverbe italien : « rien que du fumet, point de rôti ».